 Chacun ses trucs.
Chacun ses trucs.
Tout médecin, même un généraliste, a des domaines qu’il aime et d’autres moins ; des choses qu’il maîtrise et d’autres qu’il tâche d’éviter.
Question de goûts personnels, de hasards lors du cursus des études, d’opportunités, de géographie.
Si vous vous êtes tordu une cheville ou fait un lumbago, vous n’êtes pas obligé de venir me voir.
Je ne serai peut-être pas totalement nul, mais je ne serai pas très bon non plus. Et en tout cas, vous aurez du mal à me motiver.
Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce qui concerne les muscles et le squelette, je n’ai jamais réussi à m’y intéresser vraiment. Et puis, de toute façon, ça se termine quand même à peu près toujours pareil : paracétamol, antiinflammatoires, repos. Parfois une attelle.
Si vous avez un enfant à me montrer, par contre, vous serez les bienvenus : ça m’amuse et je saurai m’y prendre.
Si vous avez un problème de cardiologie ou de médecine interne, venez ! Je suis à peu près au point et je vais me passionner à décortiquer votre cas.
Si vous faites un infarctus ou un coma hypoglycémique, faites-moi appeler ! J’ai fait quelques mois de SAMU et j’aime me sentir vraiment utile.
Si c’est pour de la gynécologie, asseyez-vous. Vous réveillerez mes instincts militants et j’adorerai prendre un long moment pour tout vous expliquer en détail.
Mais si, vraiment, vous voulez me faire plaisir, venez avec une belle balafre. Une plaie, une blessure, une mandale, une entaille, une coupure, une estafilade. Ou bien encore un kyste sébacé à exciser, voire une kératose mal placée. Là, ce sera chouette.
Car, oui, j’aime les travaux manuels. C’est peut-être une des raisons qui m’a amené dans ce coin perdu. Les confrères qui sont installés près des villes ne font presque plus ces gestes : les gens ont pris l’habitude d’aller aux Urgences ou chez le spécialiste. Ici, ils sont généralement contents de ne pas avoir à se taper la longue route.
Petit à petit d’ailleurs, j’ai gagné en assurance. Il m’est arrivé également, au début, d’envoyer des patients chez le dermatologue, le chirurgien ou l’urgentiste. Et je me suis rendu compte que, bien souvent, j’aurais fait aussi bien ou même mieux sur le plan esthétique. Aujourd’hui, il faut vraiment que la plaie soit très moche ou la lésion vraiment inquiétante pour que je renonce.
Donc si vous vous êtes mis un coup de cutter ou qu’une vache vous a planté son sabot dans le tibia, venez me voir !
Je vous installerai bien à l’aise sur ma table d’examen, je désinfecterai votre blessure, je ferai une anesthésie pour que vous n’ayez pas mal. Je sortirai mon matériel stérile.
Et puis je m’attellerai au travail.
Telle une couturière appliquée, je choisirai ma technique, car nous sommes dans le sur-mesure : un point en Y ? Un point inversé profond ? Un invisible surjet intradermique que personne d’autre ne sait faire dans les environs ?
Scalpel, pincette, ciseaux, aiguille montée, je laisserai alors mes mains virevolter, en tirant un peu la langue. Parfois, je travaillerai en silence, laissant échapper un juron de temps en temps, parfois nous ferons la causette. En tout cas, mon esprit sera au repos. Comme j’aime ces moments de relâche entre un diabétique hypertendu artéritique et un patient dépressif !
Paradoxe du système français qui privilégie la technique à l’intelligence : ces gestes de petite chirurgie sont très bien rémunérés. C’est bien souvent le montant de trois ou quatre consultations sans être forcément plus long et bien moins épuisant.
Lorsque nous arriverons sur la fin, je ferai mes nœuds en vous laissant regarder, un coup à l’endroit, un coup à l’envers, vous me prendrez un peu pour un magicien.
Si ma secrétaire avait été là elle serait venue m’aider, car elle adore ça.
Et une fois venu le moment du pansement final, elle vous aurait dit, un peu pour vous rassurer, un peu par fierté d’entreprise « Et voilà, c’est fini. Le docteur Borée a encore fait de la haute couture pour vous. »




 Phloroglucinol, carbocistéine, Exacyl, buflomedil…
Phloroglucinol, carbocistéine, Exacyl, buflomedil…

 Je suis régulièrement effaré de voir passer sur une même ordonnance des antihypertenseurs, et en particulier des diurétiques, et des formes de Paracétamol effervescentes.
Je suis régulièrement effaré de voir passer sur une même ordonnance des antihypertenseurs, et en particulier des diurétiques, et des formes de Paracétamol effervescentes. C’est un terme qui se discute. Presque un oxymore.
C’est un terme qui se discute. Presque un oxymore.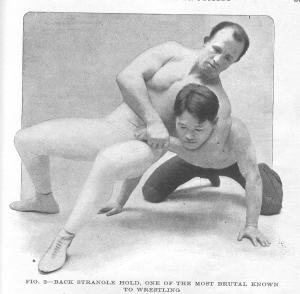
 Ça y est, je l’ai fait !
Ça y est, je l’ai fait !